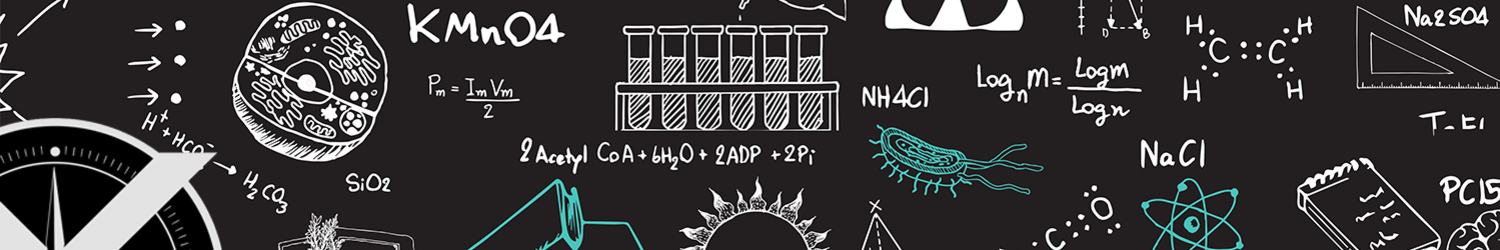À Madagascar, les microcèbes sèment l’espoir
Publié par IRD Occitanie, le 24 juillet 2025 300
De tout petits lémuriens pourraient participer à la régénération des forêts sèches de Madagascar en dispersant une grande diversité de graines.
Forêts malgaches et lémuriens sont étroitement liés : les premières abritent les seconds, qui, en retour, contribuent à leur renouvellement en dispersant les graines. Si cette interdépendance a pu, par le passé, accentuer la vulnérabilité des écosystèmes — comme en témoignent les conséquences néfastes de la disparition de la mégafaune (lémuriens géants, oiseaux éléphants, etc.) sur les écosystèmes de l’île — elle peut aussi renforcer leur résilience. C’est ce que met en avant une étude portée par Jörg Ganzhorn, ses collègues de l’IRD et leurs partenaires Malgaches, sur la contribution potentielle des microcèbes dans la restauration forestière à des stades précoces. En dispersant les graines d’herbes, d’arbustes pionniers et de certains grands arbres, ces petits lémuriens pourraient jouer un rôle fondamental lorsque la végétation restaurée ne peut pas encore attirer les grands disperseurs de graines, comme les lémuriens de plus grande taille. De quoi en faire un genre ciblé par le concept de « restauration facilitée ».
Minuscules mais robustes
Le genre des microcèbes compte les plus petits primates du monde, dont certains ne sont pas plus gros qu'une souris.
© Jordi Salmona
Parmi la mosaïque d’espèces qui peuplent Madagascar, les microcèbes se distinguent à plus d’un titre. Plus petits primates au monde, dont certains ne sont pas plus gros qu’une souris, ils jouissent d’une flexibilité alimentaire et écologique, ce qui en fait des champions de la résilience. Insectivores et frugivores, ils peuvent se développer dans de nombreux milieux, même les plus perturbés.

« Là où d’autres espèces de lémuriens disparaissent, les microcèbes prospèrent. C’est par exemple le cas dans certaines forêts dégradées par les activités humaines, où nous en avons parfois capturé jusqu’à une centaine en une journée », souligne Jordi Salmona, primatologue IRD au sein de l’UMR CRBE.
De plus, leur cycle de vie rapide et leur taux de reproduction plus élevé que chez les autres lémuriens leur permettent de se multiplier rapidement. Une abondance à même de renforcer leur impact positif sur les forêts dégradées, faisant d’eux des acteurs clés des dynamiques de restauration écologique.
Des forêts sèches vulnérables
Si les microcèbes brillent par leur adaptabilité, les forêts sèches malgaches, elles, comptent parmi les écosystèmes les plus menacés de l’île. Naturellement fragiles, elles ont une croissance très lente, adaptée à la rareté de l’eau et aux conditions climatiques extrêmes. Elles poussent difficilement et subissent donc de plein fouet les effets des activités humaines et du dérèglement climatique, pouvant mettre des décennies, voire des siècles, à se régénérer.

« La restauration des forêts sèches est un enjeu majeur à Madagascar. Mais par souci d’efficacité, les solutions mises en place privilégient plus la quantité d’arbres plantés, que la variété des espèces plantées au regard de la biodiversité préexistante », explique Stéphanie Carrière, ethno-écologue IRD au sein de l’UMR SENS.
En effet, les approches classiques reposent pour beaucoup sur la plantation d’arbres, dont les espèces, dites « pionnières », sont choisies pour la rapidité de leur croissance et leur tolérance aux conditions difficiles. Mais avec cette stratégie, de nombreux arbres et arbustes endémiques plus fragiles tendent à disparaître du paysage malgache, car il serait trop coûteux et complexe de les faire pousser en pépinière. « Or, quand certaines espèces clés disparaissent, c’est tout l’équilibre écologique qui vacille, compromettant la capacité de la forêt à se régénérer correctement », ajoute Stéphanie Carrière. D’où l’importance d’étudier d’autres stratégies de restauration, telle que la création de corridors écologiques à l’échelle du paysage.
Privilégier la restauration facilitée
Les corridors écologiques sont des zones végétalisées reliant des fragments de forêts. Ils permettent aux animaux et aux plantes de se déplacer, favorisant ainsi la régénération spontanée de la biodiversité. Leur création participe à ce que l’on appelle « la restauration facilitée », qui consiste à créer ou améliorer les conditions pour que la nature se régénère d’elle-même, sans interventions lourdes comme la plantation systématique. Favoriser la recolonisation par les microcèbes dans la mise en place de telles stratégies pourrait donc s’avérer particulièrement porteur, notamment dans les stades de restauration précoces des forêts.
« Grâce à leur régime alimentaire varié et leur grande adaptabilité aux conditions dégradées, ces petits lémuriens dispersent les petites graines, recréant une base forestière à même d’enclencher une succession écologique, attirant progressivement d’autres animaux, comme les oiseaux ou de plus gros lémuriens, qui viendront à leur tour enrichir la flore », expose Jordi Salmona.
Ainsi, sans intervention lourde ni plantations coûteuses, les microcèbes pourraient amorcer la régénération de ces écosystèmes fragiles. Un bel exemple de solutions fondées sur la nature, qui redonne un peu d’optimisme quant à l’avenir des forêts sèches malgaches et souligne combien les plus petits habitants de la forêt peuvent parfois accomplir les plus grandes choses.
Louise Hurel, IRD le Mag'
CONTACTS
- Jordi Salmona, CRBE - Centre de recherche sur la biodiversité et l’environnement (IRD/CNRS/ Toulouse INP/Université de Toulouse)
- Stéphanie Carrière, SENS - Savoirs, Environnement, Société (Université de Montpellier/IRD/Cirad)
PUBLICATION
Jörg U. Ganzhorn, Jean-Basile Andriambeloson, Silvia Atsalis, Lis M. Behrendt, Marina B. Blanco, An Bollen, Stéphanie M. Carrière, Lounès Chikhi, Mélanie Dammhahn, Guiseppe Donati, Jordi Salmona et al., Facilitated Forest Restoration Using Pioneer Seed Dispersers in Madagascar: The Example of Microcebus spp., Land. 2024
DOI : doi.org/10.3390/land1312197
Source : https://lemag.ird.fr/fr/madaga...