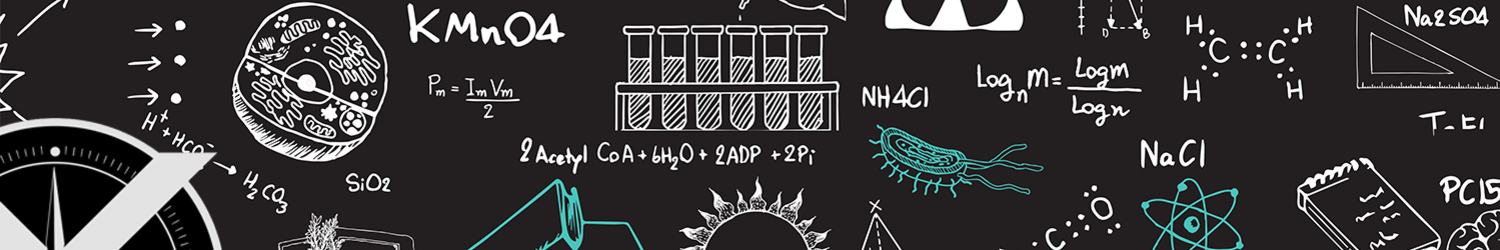Les infections virales boostées par des lipides dans la salive des moustiques
Publié par IRD Occitanie, le 30 juin 2025 560
Des lipides contenus dans la salive de moustiques vecteurs de flavivirus contribuent à affaiblir les défenses des hôtes et à doper l’infection.
La nature peut se révéler particulièrement retorse : en plus de transmettre des virus responsables de maladies graves, certains moustiques disposent de mécanismes salivaires facilitant l’infection chez les hôtes. Ces insectes hématophages, qui propagent notamment la dengue, le chikungunya, la fièvre jaune et la fièvre du Nil occidental, sont ainsi directement impliqués dans la sévérité des affections et le niveau de mortalité associé. La découverte de ce mécanisme pourrait ouvrir la voie à des traitements pour prévenir la gravité de ces affections virales.

De nombreuses recherches ont établi que les protéines contenues dans la salive de moustiques vecteurs favorisent la transmission de virus. Mais pour la première fois, nous montrons que des lipides de la salive jouent également un rôle important dans l’infection », explique Hacène Medkour, biologiste de la santé à l’IRD, au sein de l’unité MIVEGEC.
Régulation cellulaire affaiblie
Les
spécialistes de l’IRD et leurs partenaires thaïlandais ont ainsi
découvert que la salive des moustiques contient des structures abritant
des lipides. Celles-ci entrent en contact avec les cellules de l’hôte,
humain ou animal, au moment de la piqûre. Et ces lipides particuliers,
appelés sphingomyélines, inhibent alors un mécanisme cellulaire de
régulation normalement chargé d’empêcher l’accumulation anarchique de
protéines défectueuses dans la cellule de l’hôte. Une fois cette
barrière affaiblie, le virus peut produire beaucoup plus facilement ses
propres protéines — et copier abondamment son matériel génétique — à
l’intérieur des cellules de l’hôte, sans être freiné par les mécanismes
cellulaires de régulation. Dès lors, l’accumulation de protéines virales
et la réplication massive du virus dans l’organisme vont aggraver le
niveau d’infection.
« Ces lipides n’ont pas d’effet sur le système immunitaire de l’hôte, précise le scientifique. Ils agissent au niveau du métabolisme de ses cellules. »

En prenant leur repas de sang, les moustiques introduisent aussi leur salive dans l'épiderme de leur proie.
© IRD - Nil Rahola
Souris et cellules humaines
L’expérimentation
a confirmé que ces interactions moléculaires entre arbovirus,
moustiques vecteurs et hôtes ont une forte influence sur le niveau de
transmission des maladies. Ainsi, en injectant le virus dans la peau de
souris de laboratoire, pour simuler la piqûre du moustique, les
scientifiques ont pu mesurer l’impact des lipides salivaires sur la
sévérité de l’infection : les rongeurs qui recevaient des
sphingomyélines en même temps que le virus ont développé des signes
cliniques plus sévères et ont connu une mortalité plus élevée que ceux
qui recevaient l’agent pathogène seul. 70 % des souris du premier groupe
ont succombé, contre seulement 20 % de celles du second.
Le rôle des
sphingomyélines dans l’accumulation de protéines virales a aussi été
validé expérimentalement sur des tissus humains. Les scientifiques ont
infecté des cellules de la peau et des cellules immunitaires sanguines
avec les virus de la dengue, du Zika et de la fièvre du Nil occidental,
en ajoutant ou pas des lipides salivaires. Et, là aussi, les virus se
sont développés bien davantage dans les cellules en présence de
sphingomyélines. Cela suggère que ce mécanisme contribue également, chez
l’humain, à la sévérité et à la létalité des infections virales.

Cette étude, combinant nos travaux sur les mammifères hôtes et l’expertise de nos collègues de l’IRD sur les insectes vecteurs, est la deuxième que nous menons conjointement. Elle a permis des avancées scientifiques notables et a favorisé un véritable transfert de compétences, avec notamment la mise en place d’un insectarium de niveau BSL2 au sein de notre université, pour soutenir les recherches futures », indique Duncan R. Smith, le virologue qui dirige ce groupe de recherche à l’Université Mahidol, en Thaïlande.
Cette découverte pourrait également ouvrir la voie à de nouveaux outils prophylactiques, comme des crèmes ou des lotions à appliquer sur la peau, capables de neutraliser l’action des sphingomyélines présentes dans la salive des moustiques, et ainsi limiter la gravité des infections.
par Olivier Blot, IRD le Mag'
CONTACTS
Hacène Medkour MIVEGEC (IRD/CNRS/Université de Montpellier)
Duncan R. Smith Institute of Molecular Biosciences, Mahidol University, Thaïlande
PUBLICATION
Hacène
Medkour, Lauryne Pruvost, Elliott Miot, Xiaoqian Gong, Virginie
Vaissayre, Mihra Tavadia, Pascal Boutinaud, Justine Revel, Atitaya
Hitakarun, Wannapa Sornjai, Jim Zoladek, R. Duncan Smith, Sébastien
Nisole, Esther Nolte-‘t Hoen, Justine Bertrand-Michel, Dorothée Missé,
Guillaume Marti & Julien Pompon, Sphingomyelins in
mosquito saliva modify the host lipidome to enhance transmission of
flaviviruses by promoting viral protein levels, Cell Metabolism, 20 juin 2025
DOI : 10.1016/j.cmet.2025.05.015
Source : https://lemag.ird.fr/fr/les-in...