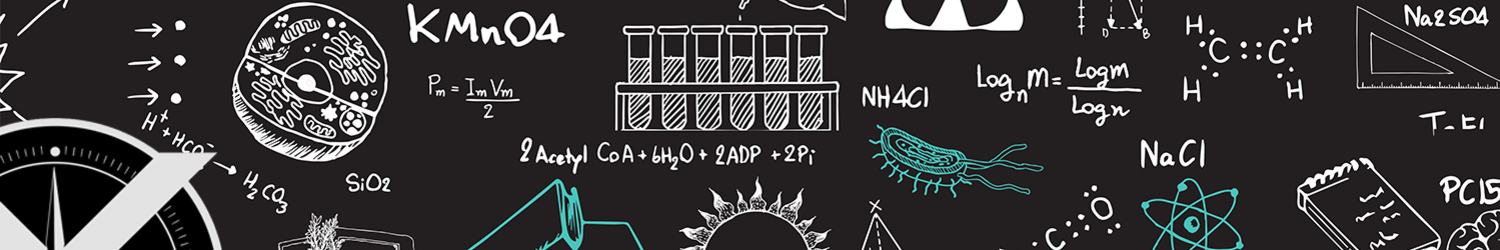Des drones pour mieux protéger les dugongs
Publié par IRD Occitanie, le 22 septembre 2025 210
Cette approche novatrice offre un suivi rapide et économique de la santé des dugongs. Un outil précieux pour orienter les actions de protection.
Les vidéos et photos prises par les touristes avec des drones peuvent contribuer à la recherche scientifique et à la préservation d’espèces menacées. C’est ainsi qu’une étude sur les dugongs a, pour la première fois, utilisé ce type d’images pour mesurer leur indice de condition corporelle (BCI). Menée par une équipe internationale incluant des chercheurs de l’IRD, cette approche innovante vise à dresser un état des lieux des réserves énergétiques des dugongs dans l’aire indo-pacifique. L’objectif : détecter rapidement d’éventuels signaux de déclin et faciliter la mise en place d’actions de conservation.

La mesure du BCI par drone a d’abord été pensée pour étudier les lamantins en captivité. Elle est calculée à partir du rapport entre la largeur du corps au niveau du ventre et la longueur totale de l’animal, et permet de récupérer de précieuses données de manière non invasive », explique Laura Mannocci, biologiste marin IRD au laboratoire MARBEC.
Une méthode novatrice
Cousin du lamantin, le dugong ne peut, lui, survivre en captivité. Réaliser des études morphologiques sur les multiples populations réparties dans l’aire indo-pacifique était jusqu’alors coûteux et complexe : elles nécessitaient de capturer les animaux, de réaliser les mesures à bord d’un bateau, puis de les relâcher. « Il était donc impossible de recueillir des données à grande échelle sur un temps court. C’est en discutant avec des collègues du LMI Selamat en Indonésie, que nous avons eu l’idée d’utiliser la mesure BCI par drone sur les dugongs. Cela nous a permis de conduire la première étude de l’état corporel de ces animaux sauvages sur l’ensemble de leur aire de répartition », raconte la biologiste. Grâce à cette méthode novatrice, l’équipe a pu analyser 272 individus répartis dans 18 pays.

Nous avons rassemblé les clichés collectés par une vaste coopération internationale, mais aussi des images publiées sur les réseaux sociaux. Ce travail minutieux nous a permis de tirer des premiers enseignements sur l’état de santé des différentes populations de dugongs. Des résultats essentiels pour orienter de futures mesures de conservation », explique Camille Goudalier, étudiante en master 2 à l'université Aix-Marseille, qui a accompli la majeure partie du travail lors de son stage au sein du laboratoire MARBEC.

Observation de dugongs par drone au Mozambique, où la population est en danger critique d'extinction.
© Mia Stawinski
Des corrélations diverses
Les premiers résultats montrent un lien entre l’état corporel et la taille des populations : plus l’indice BCI est élevé — autrement dit, plus les animaux sont « ronds » — plus les populations comptent d’individus, comme c’est le cas en Australie, au Qatar, aux Émirats arabes unis et en Nouvelle Calédonie. À l’inverse, dans les pays où les effectifs sont très réduits, comme au Mozambique, l’indice corporel est plus faible. « Il reste toutefois difficile de dire si les dugongs sont en bonne santé parce que les populations sont grandes, ou l’inverse. Des recherches complémentaires sont nécessaires », nuance Camille Goudalier.
L’étude met aussi en lumière un lien entre l’état corporel et le développement économique des pays. Dans les zones soumises à de fortes pressions humaines sur les récifs tropicaux, l’indice diminue. À l’inverse, il augmente avec le PIB par habitant. « Cette corrélation s’explique par le fait que les pays plus aisés exercent souvent moins de pressions directes sur les littoraux, et notamment les herbiers dont se nourrissent les dugongs. Ils disposent aussi de législations plus contraignantes et d’aires marines protégées plus étendues », souligne Laura Mannocci.
Les limites des aires protégées
Toutefois, la mise en place d’aires marines protégées ne suffit pas à elle seule à garantir le bon état des dugongs. Les données montrent une relation en « cloche » entre l’étendue de ces zones et l’état corporel : une étendue très large n’est pas forcément synonyme de meilleures conditions corporelles. « La question est complexe car il existe différents types d’aires, dont certaines limitent peu les pressions humaines. De plus, les dugongs disposent souvent de territoires plus vastes que ces zones et ne restent pas cantonnés à l’intérieur », précise la chercheuse.

Observation de dugongs par drone en Indonésie.
© Muhammad Rizki Nandika, LMI SELAMAT
Sentinelles des écosystèmes marins
« Ces résultats restent à être approfondis, mais ils offrent déjà un nouvel éclairage sur les conditions de vie des dugongs et leur évolution », souligne Laura Mannocci. Ils permettent aussi de valider une méthode qui permettra de surveiller et protéger plus efficacement ces animaux sauvages. Alors que les scientifiques s’appuyaient jusqu’à présent sur le déclin des populations, qui se calcule sur dix ou vingt ans, l’observation du déclin des conditions corporelles par drone offre un moyen beaucoup plus rapide, à large échelle et à moindre coût de surveillance des populations. « Cela nous permettra non seulement de mettre en place des actions ciblées, mais en plus d’utiliser les dugongs comme sentinelles de l’état de santé plus général de l’écosystème », conclut Camille Goudalier.
Louise Hurel, IRD le Mag'
CONTACTS
Laura Mannocci, MARBEC (IRD/CNRS/Ifremer/Université de Montpellier/Inrae)
Camille Goudalier, MARBEC (IRD/CNRS/Ifremer/Université de Montpellier/Inrae)
PUBLICATION
Camille Goudalier, David Mouillot, Léa Bernagou, Taha Boksmati, Caulvyn Bristol, Harry Clark, Sekar M.C. Herandarudewi, Régis Hocdé, Anna Koester, Ashlie J. McIvor, Dhivya Nair, Muhammad Rizki Nandika, Louisa Ponnampalam, Achmad Sahri, Evan Trotzuk, Nur Abidah Zaaba & Laura Mannocci, Drone photogrammetry reveals contrasting body conditions of dugongs across the Indo-Pacific, Remote Sensing in Ecolology and Conservation, june 2025
https://doi.org/10.1002/rse2.70016
Source : https://lemag.ird.fr/fr/des-dr...